Les commotions cérébrales, ce poison
Basé sur un Article paru sur Eurosport.fr,
9/19/20252 min read
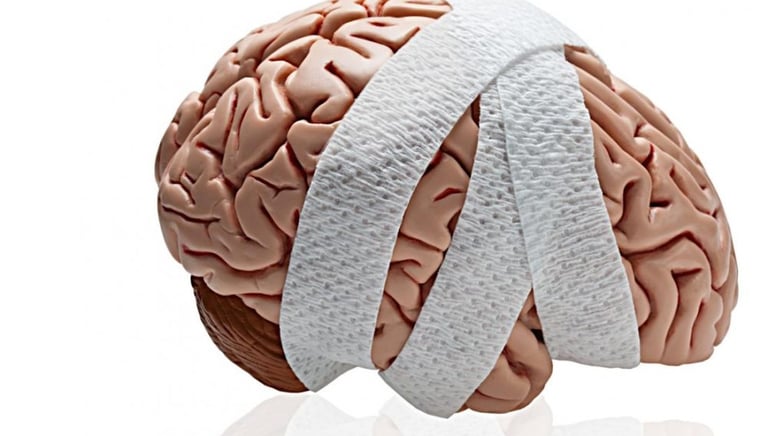
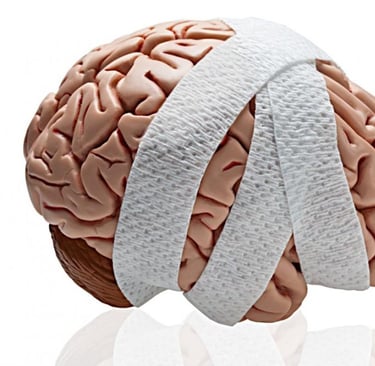
Les commotions cérébrales dans le rugby : blessures invisibles, témoignages bouleversants
Dans le monde du rugby, les commotions cérébrales sont un sujet brûlant. Si invisibles qu'elles sont parfois minimisées, elles peuvent pourtant bouleverser la vie des sportifs et stopper net des carrières prometteuses.
L’article d’Eurosport rapporte les témoignages poignants de joueurs et joueuses internationaux français, notamment Paul Willemse, Romane Ménager et Jade Ulutule, lors d’un Grenelle organisé par Provale. Tous évoquent la difficulté de reconnaître et de gérer une commotion cérébrale, souvent masquée par la culture du courage et de l’endurance dans ce sport.
Paul Willemse, deuxième ligne de Montpellier et du XV de France, avoue ne pas s’être rendu compte immédiatement de ses commotions successives. Arrêté depuis plusieurs mois après une nouvelle blessure, il souligne le caractère insidieux de ces traumatismes : “Je restais dans le ruck après un déblayage, en train de ‘dormir’ sans m’en rendre compte.”
Romane Ménager, troisième ligne des Bleues, accumule neuf commotions en carrière. Elle raconte comment, après la dernière, la convalescence a duré quatre mois, bien plus que les dix jours habituels, la forçant à renoncer au Mondial 2025. Le quotidien est bouleversé : fatigue extrême, maux de tête, oppression crânienne, journées avec des hauts et des bas.
Jade Ulutule, internationale à VII, a quant à elle dû renoncer aux Jeux Olympiques après un choc non détecté en match. Elle confesse souffrir encore aujourd’hui de troubles du sommeil, de maux de tête et d’oublis répétitifs dans les gestes simples de la vie.
Tous insistent sur le côté invisible et pernicieux de la commotion, qui ne se traduit pas comme une blessure visible — “Il n'y a pas de signes que tu n’es plus capable de jouer, ce n’est pas une jambe cassée”, résume Willemse. L’acceptation de la blessure est aussi psychologiquement difficile, car il n’existe pas un protocole universel : chaque sportif réagit différemment.
Des progrès sont toutefois notés dans l’accompagnement médical, surtout chez les internationaux, mais il reste beaucoup à faire, notamment dans les divisions féminines et chez les non-professionnels. Enfin, les joueurs appellent à considérer la commotion comme la plus grave des blessures du rugby, pour mieux la prévenir et la traiter.
Pour découvrir les témoignages complets et l’article original :
Consulter l’article Eurosporteurosport
Contact
Philippe FOUILLEN
Masseur-Kinésithérapeute D.E.
📍 24 Allée François Joseph Broussais 56000 Vannes
📞 02 97 40 59 40
✉️ kine@fouillen.fr
Informations Légales
• Politique de Confidentialité (RGPD)
• Cabinet accessible PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
• N° Adeli : 567013792
